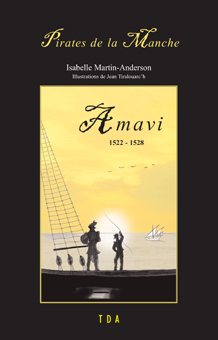Pirates de la Manche
Avant les Caraïbes, c’est dans l’étroite mer de la Manche, entre Angleterre, France et Flandres, que la piraterie est vraiment née.
Si on oublie les pirates barbaresques de Méditerranée, naturellement. Mais ce n’est pas notre sujet (pour l’instant).
Revenons à la Manche…
Avant des zones comme Malaca ou le golfe Persique (aujourd’hui), ou la mer des Antilles (au XVIIème siècle), le lieu où convergeaient toutes les marchandises du monde fut un temps, la Manche – l’English Channel, la Mer Bretonne.
Les riches toiles de Morlaix y croisaient l’étain d’Angleterre, les épices voyageaient du Portugal aux Pays-Bas, et c’était là qu’arrivaient les pêcheurs de Terre-Neuve.
Oui, de Terre-Neuve : depuis 1454 environ, les moines de Beauport, en Bretagne, y envoyaient leurs bateaux.
1454, oui…
Pas 1492.
Et qui dit nombreux navires marchands bourrés de richesses, dit… envieux ! Et l’envie, en mer, c’est la piraterie !
La piraterie si on capture n’importe qui – la course si on ne s’attaque qu’aux navires ennemis.
Même si on est encore loin de la première lettre de marque – et donc du premier corsaire de l’histoire.
Dès 1480, la course est encouragée par le vice-amiral Guillaume de Casenove pour le roi Louis XI. Et en 1484, le morlaisien Jean de Coëtanlem se proclame « roi et gouverneur de la mer ». Pirate devenu richissime, il s’exilera au Portugal en 1492.




1492, encore…
Toutes les richesses des Indes Occidentales vont débarquer en Espagne et au Portugal.
Mais c’est oublier une autre histoire – une histoire qui se mêle à la géographie.
Ils étaient trois, presque du même âge. Ils étaient montés chacun sur son trône à quelques années d’intervalle.
L’un rêvait fastes, splendeur, brillance. Il était roi de France.
L’autre ne vivait que du pouvoir de sa nation, strictement, ascètement. Il tenait l’Espagne.
Le troisième larron, entre les deux, n’était que désir, plaisir… luxure ? Il régnait sur l’Angleterre.
Et un quatrième se mêla à la partie : il pensait servir d’arbitre entre les trois autres. Il dirigeait toute la chrétienté.
Cela entraîna des guerres sans nombre.
Et c’est le numéro deux qui gagna.
Lorsque Charles d’Espagne devint Charles Quint des Pays-Bas, toutes les richesses d’Espagne furent livrées à… Anvers, Amsterdam…
En passant par où ? Pas par la terre !
C’est ainsi que des ports innombrables prirent de l’importance.
En venant des Flandres, et passés le flamand Dunkerque et l’anglais Calais, ce seront l’actif Boulogne, l’immense Dieppe (2ème port de France), le vieil Harfleur (bientôt remplacé par une ville neuve voulue par François Ier, baptisée Le Havre de Grâce), le très actif Honfleur, le sage Barfleur et le puissant Cherbourg, pour la Normandie.
Puis, en suivant les côtes, nous visiterons le débutant Saint-Malo, le poissonneux Paimpol, le riche Morlaix, le débutant Roscoff, le grand Porspoder, sans aller jusqu’au petit port de Brest.
La Manche s’arrête là côté France.
Au nord, elle débute aux Sorlingues – ces îles qu’on appelle aujourd’hui les Scilly. A l’époque, les cartes étaient en français !
Ensuite, en suivant les côtes anglaises vers l’est, on trouve les pirates de Penzance, les contrebandiers de Falmouth, les commerçants de Plymouth, les hors-la-loi de Poole, les militaires de Portsmouth… et les marins multi-disciplinaires des Cinque Ports (oui, on parle toujours français) : Hastings, Romney, Hythe, Douvres et Sandwich.
Une promenade historique dans les villes côtières au XVIème siècle
1525, c’est le moment où la plupart de nos « cités corsaires » sont nées.
A quoi ressemblaient Honfleur, Dieppe ou Anvers en pleine Renaissance ?
Au-delà des bâtiments encore visitables, il suffit de se rappeler que l’incendie de 1522 a amené la construction des curieuses maisons à pondalez de Morlaix, que la première église de Roscoff sort de terre, que Le Havre n’est qu’une forteresse assortie d’une zone d’échouage… et que tous les grands de ce monde rendent visite, à Dieppe, à un certain Jean Ango. François Ier, les Médicis, le Pape, viendront lui rendre visite (et lui emprunter de l’argent). Léonard de Vinci décorera sa résidence d’été.
C’est ce même Jean Ango qui financera les équipées des frères Verrazano, découvrant dès 1524 le site du futur New York, et la quasi-totalité des côtes américaines du nord de la Floride au Canada (10 ans avant Jacques Cartier !).
Des exploits quand on connaît les moyens de l’époque
En ce XVIème siècle débutant, on ne connaît ni le nord, ni le sud, on n’a exploré que les côtes d’Afrique et d’Asie (pas l’intérieur des terres), on pense que le passage vers le Pacifique se fait au nord de la Floride.
Les techniques astronomiques mettent la Terre au centre du monde, toutes les planètes et le Soleil tournant autour.
On n’a aucune idée de ce que sera la longitude.
Les instruments de navigation sont imprécis ; la boussole inconnue de beaucoup.
Et on ne connaît même pas le mot « carte ». Même si les cartographes d’Amerigo Vespucci ou d’Henri le Navigateur ont déjà dressé des portulans, la carte officielle du monde est décidée par l’Eglise. Pour elle, la Terre est un disque plat, entouré d’eau, et le point le plus haut, c’est le Paradis Terrestre, situé sur les Lieux Saints.
Pas facile de naviguer dans ces conditions !